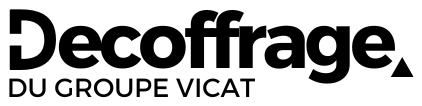- Guides > Classification des bétons
Classification des béton et normes
Le 17 mars 2025 - ⏱️️ 9 min - Manon
Votre projet en béton
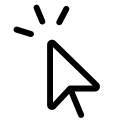
Introduction
Le béton est un matériau de construction essentiel, utilisé dans une grande variété de projets, allant des simples fondations aux structures complexes. Sa performance et sa durabilité dépendent de plusieurs critères, notamment sa résistance, son exposition aux agressions extérieures et sa consistance lors de sa mise en œuvre.
Dans cet article, nous allons explorer trois aspects fondamentaux du béton :
- Les différentes classes de résistance du béton, qui définissent sa capacité à supporter des charges et des contraintes mécaniques.
- Les différentes classes d'exposition du béton, qui déterminent son aptitude à résister aux conditions environnementales, comme l'humidité, le gel ou les substances chimiques agressives.
- Les différentes classes de consistance du béton, qui influencent sa maniabilité et sa mise en place sur le chantier.
Comprendre ces classifications est essentiel pour choisir le béton le plus adapté à chaque usage et garantir la pérennité des ouvrages.

1. Les différentes classe de résistance du béton
Définition
Le béton possède une excellente résistance à la compression, mais sa résistance à la traction est relativement faible. C'est pourquoi il est renforcé par des armatures.
La résistance à la compression est le principal critère de performance du béton durci. Elle sert de base aux calculs et au dimensionnement des structures en béton. Cette résistance dépend notamment du dosage et du type de ciment, ainsi que de la quantité d’eau utilisée.
Le béton est classé en fonction de sa résistance mécanique en compression, évaluée à 28 jours et exprimée en méga-pascals (MPa). La norme NF EN 206+A2/CN définit 16 classes de résistance pour les bétons normaux.
Lors de l’achat de béton, il est essentiel d’indiquer au fabricant (centrale à béton) la classe de résistance souhaitée. Ce choix doit être effectué parmi les classes définies par la norme afin de garantir une résistance précise et sans ambiguïté.
Comprendre une classe de résistance
La classe de résistance du béton à 28 jours est notée par la lettre C (pour "Concrete"), suivie de deux valeurs représentant la résistance mesurée sur éprouvettes cylindriques et cubiques (exemple : C25/30, C30/37).
Ces classes correspondent à des résistances caractéristiques, c'est-à-dire des valeurs contractuelles auxquelles le fabricant s’engage.
Les différentes classes de résistance du béton
Le tableau suivant regroupe les 16 classes de résistance des bétons courants, conformément à la norme NF EN 206/CN.
Classe de résistance à la compression | Résistance caractéristique minimale sur cylindres : N/mm2 | Résistance caractéristique minimale sur cubes : N/mm2 |
| C8/10 | 8 | 10 |
| C12/15 | 12 | 15 |
| C16/20 | 16 | 20 |
| C20/25 | 20 | 25 |
| C25/30 | 25 | 30 |
| C30/37 | 30 | 37 |
| C35/45 | 35 | 45 |
| C40/50 | 40 | 50 |
| C45/55 | 45 | 55 |
| C50/60 | 50 | 60 |
| C55/67 | 55 | 67 |
| C60/75 | 60 | 75 |
| C70/85 | 70 | 85 |
| C80/95 | 80 | 95 |
| C90/105 | 90 | 105 |
| C100/115 | 100 | 115 |
Classes de résistance du béton
Ces classes s’appliquent aux bétons de masse volumique normale et aux bétons lourds. Pour les bétons légers, des classes spécifiques, désignées par "LC" au lieu de "C", sont utilisées.
Choix de la classe de résistance
La classe de résistance du béton destiné à une structure est déterminée lors du calcul de dimensionnement de l’ouvrage, conformément aux Eurocodes, qui régissent la conception et le calcul des structures en béton armé.
La responsabilité de cette détermination revient à un bureau d’études spécialisé pour les grands chantiers, ou à l’entreprise réalisant les travaux pour les ouvrages plus modestes.
Si un calcul de dimensionnement a été effectué, il convient de se référer à la note de calcul, qui précise la classe de résistance en compression du béton à 28 jours.
Résistance et durabilité
La classe de résistance calculée pour l’ouvrage est indépendante des exigences minimales fixées par la norme NF EN 206+A2/CN en matière de durabilité.
Cette norme définit des classes de résistance minimales selon la classe d’exposition du béton, afin de garantir sa pérennité dans son environnement.
Tableau de correspondance entre classe d’exposition et classe minimale de résistance
| Classe d'exposition | Classe de résistance minimale du béton |
| _ |
| C20/25 |
| C25/30 |
| C30/37 |
| C35/45 |
| C40/50 |
Il est recommandé de vérifier que la classe de résistance calculée pour l’ouvrage correspond bien à celle exigée par la norme NF EN 206+A2/CN pour assurer la durabilité du béton. Dans certains cas, la classe de résistance finale nécessaire peut être supérieure à celle prévue initialement pour répondre aux contraintes environnementales.
Recommandations pour les petits ouvrages
Pour les petits ouvrages ne nécessitant pas d’étude de dimensionnement, il est possible de s’appuyer sur la norme NF EN 206+A2/CN pour choisir une classe de résistance adaptée. En général, des bétons prêts à l’emploi de classe C20/25 à C30/37 suffisent pour ces applications.
Exemples d’application des classes de résistance:
- Pour une dalle extérieure, il est recommandé d'utiliser un béton de classe C25/30, correspondant à une classe d'exposition XF1. Si cette dalle est soumise à des sels de déverglaçage, la classe d’exposition devra être XF2, tout en conservant une résistance minimale de C25/30 afin de garantir une meilleure résistance aux cycles gel/dégel.
- Pour une dalle intérieure, un béton de classe C20/25 sera suffisant, avec une classe d’exposition XC1, adaptée aux environnements intérieurs peu agressifs.
- Les fondations nécessitent un béton de classe C20/25, avec une classe d’exposition XC2, prenant en compte l'humidité modérée du sol.
- Pour la réalisation d’une table de compression sur un plancher poutrelles/hourdis, il est préconisé d’utiliser un béton de classe C25/30, en classe d’exposition XC1, adaptée aux environnements intérieurs protégés de l’humidité excessive.
- Enfin, pour une plage de piscine, qui est soumise à des risques d’agressions chimiques, notamment par l’eau chlorée, il est recommandé d’opter pour un béton de classe C30/37, avec une classe d’exposition XD2, garantissant une meilleure résistance à la corrosion induite par l’eau.
Ainsi, le choix de la classe de résistance du béton doit tenir compte à la fois des exigences de dimensionnement et de durabilité, afin de garantir la sécurité et la longévité de l’ouvrage.

2. Les différentes classes d'exposition du béton
1. Pourquoi les classes d'exposition sont-elles importantes ?
Pour assurer la durabilité d'un ouvrage en béton, il est essentiel que la formulation du béton soit adaptée aux conditions environnementales auxquelles il sera exposé. En effet, tout au long de sa vie, le béton subit diverses agressions pouvant compromettre sa résistance, telles que :
Le gel et le dégel
L'exposition aux sels de déverglaçage
Les attaques chimiques (acides, sulfates, etc.)
L'exposition aux chlorures (provenant de l'eau de mer ou d'autres sources)
La norme NF EN 206/CN prend en compte ces contraintes en définissant des classes d'exposition, qui permettent d'adapter la composition du béton selon le contexte d'utilisation.
Les classes d'exposition :
Catégorie | Classe | Description de l'environnement |
| Aucune agression | X0 | Aucune exposition à la corrosion ni aux attaques chimiques |
| Corrosion des armatures par carbonatation | XC1 | Humide ou sec en permanence |
| XC2 | Le plus souvent humide, rarement sec | |
| XC3 | Humidité modérée | |
| XC4 | Alternance d'humidité et de séchage | |
| Corrosion par les chlorures (hors eau de mer) | XD1 | Humidité modérée |
| XD2 | Le plus souvent humide, rarement sec | |
| XD3 | Alternance d'humidité et de séchage | |
| Corrosion par les chlorures de l'eau de mer | XS1 | Exposition à l'air salin (sans contact direct avec l'eau) |
| XS2 | Immerge en permanence dans l'eau de mer | |
| XS3 | Exposition à des projections d'eau de mer, embruns ou zone de marnage | |
| Gel/Dégel avec ou sans agents de déverglaçage | XF1 | Gel faible ou modéré, sans ou peu de salage |
| XF2 | Gel faible ou modéré, avec salage fréquent | |
| XF4 | Gel sévère, avec salage fréquent | |
| XA1 | Faible agressivité chimique | |
| Attaques chimiques | XA2 | Agressivité chimique modérée |
| XA3 | Forte agressivité chimique |
3. Comment choisir la bonne classe d'exposition ?
Le choix de la classe d'exposition dépend de l'ouvrage à réaliser et de son environnement. Voici les principales étapes pour choisir la bonne classe :
Identifier l'environnement du béton :
Est-il exposé à l'humidité ?
Sera-t-il soumis à du sel de déverglaçage ?
Y a-t-il des produits chimiques agressifs dans l'environnement ?
Vérifier les conditions climatiques locales, notamment en cas de risque de gel/dégel.
Consulter les spécifications du projet et les recommandations des professionnels.
Si le béton est exposé à plusieurs agressions, une combinaison de classes d'exposition peut être nécessaire.
Exemple d'application
| Type d'ouvrage | Environnement | Classe recommandée |
| Dalle intérieure | Aucun risque | X0 |
| Fondations | Humidité modérée | XC2 |
| Parking extérieur | Exposé au sel | XF4 |
| Pont côtier | Projections d'eau de mer | XS3 |
| Station d'épuratio | Agressivité chimique | XA3 |
4. Importance de la classe d'exposition lors de la commande du béton
Lors de la commande du béton, il est essentiel de préciser la classe d'exposition appropriée. La centrale à béton ajustera ainsi la formulation du béton en conséquence, garantissant :
Une meilleure résistance et durabilité
Une conformité à la norme NF EN 206/CN
Un coût adapté aux performances requises
En cas de doute, il est recommandé de demander conseil à un expert ou à la centrale à béton avant de finaliser la commande.
Ainsi, la prise en compte des classes d'exposition permet de garantir la qualité et la pérennité des ouvrages en béton tout en optimisant les coûts et la maintenance à long terme.

3. Les différentes classes de consistance
Les différentes classes de consistance du béton
Quel type de consistance pour le béton prêt à l’emploi choisir ?
Béton S1 : Utilisé dans la voirie (chaussées, séparateurs de voies, etc.). Il nécessite des machines spécifiques et un compactage puissant. Il est aussi utilisé pour les bétons fermes pris sous-centrale.
Béton S2 : Destiné aux ouvrages en pente, comme les descentes de garage.
Béton S3: Le plus courant pour les ouvrages standards (dalles, voiles, poteaux, poutres, fondations). Très plastique et maniable, il est adapté aux bétons traditionnels.
Béton S4 (fluide): Utilisé dans les structures verticales et horizontales (ne pas dépasser 2% de pente). Il facilite le remplissage des coffrages complexes, améliore les parements, et réduit la nécessité de vibration. Sa maniabilité est accrue sans ajout d’eau, grâce à des adjuvants fluidifiants.
Béton S5: Très fluide, incluant les bétons autoplaçants. Ceux-ci se compactent sous leur propre poids, éliminant le besoin de vibration. Ils sont utilisés pour des applications horizontales et verticales. Leur fluidité est obtenue avec des superplastifiants et des additifs comme le filler calcaire.
L’ouvrabilité : la qualité du béton frais
L'ouvrabilité, ou maniabilité, définit la capacité du béton frais à remplir les coffrages et à enrober les armatures de manière adéquate. Elle dépend de plusieurs facteurs, tels que le type et le dosage du ciment, la qualité des granulats, l'utilisation d'adjuvants et la teneur en eau. Cette dernière a un impact direct sur le comportement du béton frais, mais une teneur en eau excessive peut être nuisible en créant des problèmes comme le ressuage, une diminution des résistances mécaniques, une porosité accrue, et des risques de ségrégation ou de fissuration.
Mesure et contrôle de l’ouvrabilité
La consistance, caractérisant l'ouvrabilité du béton, est mesurée à l'aide du test de l'affaissement au cône d'Abrams, ou "slump test". Ce test consiste à remplir un moule tronconique de béton, le compacter en trois couches, puis à mesurer l'affaissement du béton après avoir retiré le moule. Les classes de consistance sont définies selon la norme NF EN 206/CN.
La norme NF EN 206/CN définit les exigences relatives :
- aux composants du béton,
- aux caractéristiques du béton frais et durci, ainsi qu'à leur contrôle,
- aux restrictions sur la composition du béton,
- à la spécification du béton,
- à la livraison du béton frais,
- aux procédures de contrôle de production,
- aux critères et à l’évaluation de la conformité.
Elle s’applique, avec son Complément National, lorsque le béton est utilisé en France.
Cette norme établit les dispositions supplémentaires nécessaires à l'application de la norme européenne EN 206 en France (remplaçant les normes EN 206-1 et EN 206-9), en tenant compte des particularités climatiques et des méthodes de construction spécifiques au pays.
Les différentes classes de consistance du béton :
| Classe | Affaissement en mm | Désignation de la consistance |
| 10 à 40 mm | Ferme |
| 50 à 90 mm | Plastique |
| 100 à 150 mm | Trés plastique |
| 160 à 210 mm | Fluide |
| 220 mm | Trés fluide |
Cas spécifique du béton autoplaçant (BAP)
Pour le béton autoplaçant, la classe d'affaissement est S5. Cependant, au-delà de 220 mm, l’essai de l’affaissement n’est plus précis. Il est alors recommandé d'utiliser l’essai d’étalement (slump flow), mesurant le diamètre moyen de l’étalement du béton. Ce test est effectué en plaçant le cône d'Abrams sur une plaque plane, puis en mesurant la flaque d’étalement obtenue.
Les classes d'étalement sont :
- SF1 : 550 à 650 mm
- SF2 : 660 à 750 mm
- SF3 : 760 à 850 mm
Les classes SF1 et SF2 sont couramment utilisées pour des applications horizontales et verticales, tandis que SF3 est réservé à des applications spécifiques, comme les voiles de grande hauteur ou les bâtiments nécessitant des parements soignés.
Conclusion
- En conclusion, les classes d’exposition, de consistance et de résistance sont des paramètres fondamentaux qui déterminent les performances et la durabilité du béton en fonction de son usage et de son environnement.
- Les classes d’exposition caractérisent les conditions environnementales auxquelles le béton sera soumis (humidité, gel, agents chimiques, chlorures, etc.). Elles permettent d’adapter la composition du béton pour garantir sa durabilité face aux agressions extérieures. Par exemple, un béton utilisé en milieu marin (classe d’exposition XS) devra être plus résistant aux chlorures qu’un béton employé en milieu sec (classe X0).
- Les classes de consistance, quant à elles, définissent la fluidité et l’ouvrabilité du béton frais, influençant ainsi sa mise en place et son mode de compactage. Elles sont déterminées principalement par l'affaissement au cône d’Abrams et vont de S1 (béton très sec) à S5 (béton très fluide). Le choix de la consistance dépend du mode de mise en œuvre : un béton autoplaçant nécessitera une consistance fluide (S5), tandis qu’un béton destiné à des ouvrages massifs nécessitera une consistance plus faible pour éviter le ressuage.
- Enfin, les classes de résistance définissent la capacité du béton durci à supporter des contraintes mécaniques. Elles sont exprimées sous forme de couple (ex : C25/30), où la première valeur indique la résistance caractéristique en compression sur éprouvettes cylindriques (MPa) et la seconde sur éprouvettes cubiques. Ce paramètre est essentiel pour dimensionner les structures en fonction des charges à supporter, garantissant ainsi leur stabilité et leur sécurité.
- Ainsi, bien que ces trois classifications concernent des aspects différents du béton (durabilité, mise en œuvre et résistance mécanique), elles sont complémentaires et doivent être prises en compte conjointement pour assurer la qualité et la pérennité des ouvrages en béton.